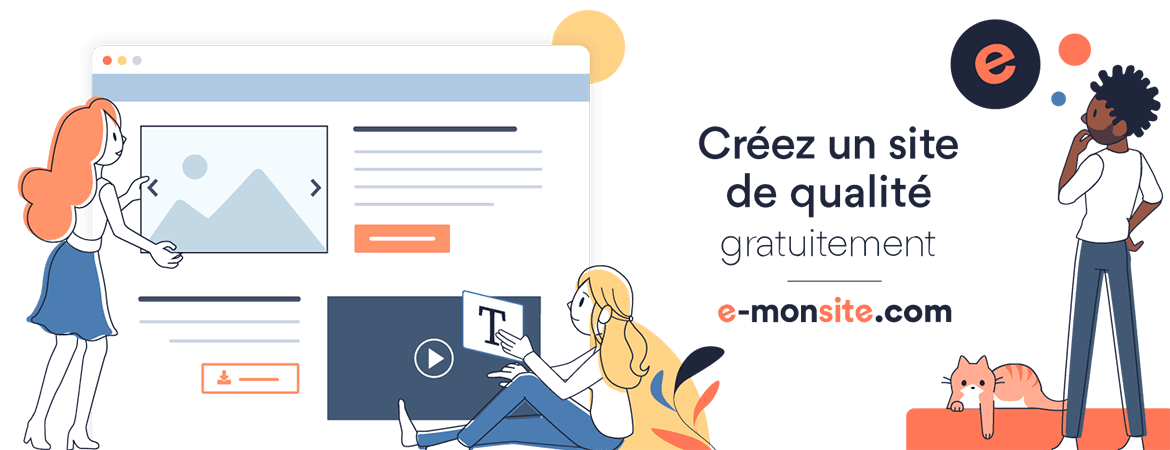L’AMOUR ENTRE DEUX LIVRES
Nouvelle de Gérard MOREL parue dans le N° 3070
de l’hebdomadaire NOUS DEUX (2 Mai 2006)
Cela peut vous paraître étrange, ou même incroyable, mais j’ai l’impression d’avoir commencé à vivre seulement quand j’ai su lire. J’avais sept ans lorsque j’ai été capable d’ouvrir un livre et de me plonger dans les aventures qui y étaient racontées, et immédiatement j’ai cessé de me sentir seule.
Il me faut vous préciser ici que ma petite enfance n’était pas très gaie, puisque mes parents avaient divorcé dès ma naissance, et étaient partis se remarier chacun de son côté, en m’oubliant chez l’une de mes grands-mères.
J’ai donc vécu de façon assez isolée les premières années de ma vie, et je n’ai compensé l’absence de tendresse familiale que par la lecture. Déjà, j’y consacrais tous mes moments de détente. Dès que mes devoirs du mercredi étaient achevés, je m’enfermais avec les héros de la comtesse de Ségur ou les petits aventuriers du Club des Cinq. Ces personnages-là étaient mes amis, mes complices ou mes modèles. Plus tard, j’ai failli tomber amoureuse de d’Artagnan, le plus célèbre des mousquetaires d’Alexandre Dumas, mais je me suis aperçue qu’il manquait de fantaisie lorsque j’ai découvert Solal, le héros passionné et flamboyant de « Belle du seigneur ».
Grâce aux livres je me suis reconstitué une famille avec les Parents Terribles (de Cocteau), la Cousine Bette (de Balzac), le malheureux Oncle Tom (de Beecher Stowe), etc…
J’ai poursuivi cette passion à travers des études de lettres, ce qui m’a permis de devenir professeur de français à vingt-quatre ans. J’ai même connu à cette époque l’ivresse de publier trois romans, qui se sont d’ailleurs trop mal vendus que je consacre davantage de temps à écrire.
Du coup, je me suis retrouvée assez disponible pour tomber amoureuse, et j’ai bientôt épousé le bibliothécaire du lycée où j’enseignais.
Nous nous aimions, bien sûr, mais surtout nous partagions une même passion pour les livres.
Assez vite, nous avons eu un fils, un garçon brillant, qui a su lire couramment avant d’avoir cinq ans.
En somme, j’ai longtemps mené une vie aussi prévisible que centrée sur la lecture. Je ne le regrettais pas, je me sentais heureuse, et je l’étais sans doute.
Parce que je ne connaissais pas encore Philippe Gaillat.
Cet homme-là est entré dans ma vie le Vendredi 18 Mars 1988 à 18 heures 30, en bousculant mes livres, à tous les sens du terme. J’avais fini mes cours assez tôt, et j’étais allée me promener le long des quais de la Seine, pour m’abreuver de la lumière acide et fraîche du printemps, tout en recherchant dans les échoppes des bouquinistes, d’anciens romans introuvables, pour mon mari, mon fils ou moi. Au bout d’une heure, j’avais feuilleté une vingtaine de livres, j’en avais acheté sept, que je n’avais pas réussi à tous entasser dans ma serviette, de sorte que j’étais plutôt encombrée. Cela ne m’a pas empêchée de m’arrêter devant une édition rare d’André Maurois, et j’en discutais le prix lorsque je me suis sentie vivement bousculée. En essayant de protéger de la chute les livres que je tenais à la main, j’ai moi-même perdu l’équilibre, et je suis tombée aux pieds de l’homme qui m’avait poussée.
Il m’a aidée à me redresser, tout en gardant au coin des lèvres un léger sourire.
Pour abréger ses excuses, je lui dis un peu sèchement que tout ceci n’était pas bien grave, puisque je n’étais pas blessée et qu’aucun de mes bouquins n’avait basculé dans le caniveau, bref j’allais reprendre cette promenade interrompue, le long des étalages de bouquinistes. Si cet homme-là avait été moins bien éduqué, il se serait éloigné en bredouillant « pardon » du bout des lèvres, et mon quotidien serait demeuré droit et paisible, comme par le passé. Je n’aurais même pas eu de regrets, puisque je n’aurais jamais su que j’étais passée à côté de ma vie, la vraie.
Mais Philippe Gaillat était courtois, de sorte qu’il s’est confondu en excuses. Ce qui m’a laissé le temps de mieux le regarder. Tout d’abord, j’ai été surprise par son bronzage. Au mois de Mars à Paris, dans la fraîcheur de ce qui ressemble plus à une fin d’hiver qu’à un début de printemps, lui il était déjà étonnamment bronzé. J’ai pensé qu’il devait rentrer de vacances, et peut-être l’ai-je envié. A moins que je n’aie eu envie d’en apprendre davantage sur lui, sous prétexte de comprendre sa décontraction apparente.
Déjà, je désirais que cette rencontre fortuite ait des répercussions sur nos vies. Sans que je comprenne pourquoi, cet homme à la quarantaine athlétique, entrevu depuis moins d’une minute, me paraissait incontournable.
Et j’ai été heureuse qu’il fasse rebondir la conversation, en me désignant de l’index l’un des livres que je venais d’acheter :
-C’est incroyable, s’est-il écrié. Il me semble reconnaître la couverture des « Moissons et Vendanges ».
Je ne pouvais que m’étonner qu’il connaisse ce roman, qui n’avait guère rencontré de succès au moment de sa parution. Je le lui dis, ce qui eut pour principale conséquence de renforcer le caractère énigmatique de son sourire.
-Vous aimerez cette histoire, osa-t-il m’affirmer, lui qui ne me connaissait pas encore. L’auteur y raconte une passion qui dure l’espace d’un été, du temps des moissons à celui des vendanges. Tout se passe en moins de trois mois, et pourtant à la fin du livre, les personnages ne sont plus ce qu’ils étaient au début. Ils se sont gorgés de la lumière de cet amour, tout comme le grain de blé mûrit dans la chaleur de l’été. C’est…
Pour lui épargner le soin de chercher ses mots, je prétendis avoir déjà lu ce livre. Ce fut à son tour de s’étonner :
-Et vous l’avez tant aimé que vous avez tenu à l’acheter ? Je devrais vous en féliciter. Mais à vrai dire, il m’est difficile de faire une critique objective, puisque je suis l’auteur de ce roman.
Je m’étais si peu attendue à cette explication, que je sursautai. Et durant deux ou trois minutes, je dus lui paraître stupide, car je ne trouvais plus rien à lui répondre. Je me mis à l’observer avec un intérêt encore accru. Il possédait des traits fins et réguliers, à peine menacés de calvitie, et il était plus grand que la moyenne, mais ces détails là ne m’apparurent que plus tard. Sur l’instant, je remarquais surtout ses yeux, qui brillaient d’un éclat presque fiévreux.
Finalement, je lui répondis sans trop réfléchir qu’avec sa silhouette de professeur de tennis, il n’avait pas l’allure que l’on attend d’un écrivain, et il me confirma que c’était là ce qu’on lui disait le plus souvent. Peut-être même était-ce l’une des raisons pour lesquelles il avait arrêté d’écrire, juste après la publication des « Moissons et Vendanges ».
-Pour une fois que je croise l’une de mes trop rares lectrices, puis-je m’autoriser à lui offrir une glace ? Il y a dans l’île Saint-Louis de quoi satisfaire les gourmandises les plus exigeantes.
Evidemment, je devais refuser. D’ordinaire, lorsque j’achète des livres, j’ai hâte de rentrer chez moi et de m’allonger sur mon lit pour les parcourir tous, pêle même, histoire de juger de la qualité de mes achats et décider de l’ouvrage que je lirai en premier.
Mais ce jour-là, mon habituelle fringale de lecture se trouvait en sommeil. J’avais davantage envie d’apprendre à connaître Philippe Gaillat.
Je le suivis donc jusqu’à l’étroite terrasse d’un célèbre glacier. Nous étions assis côte à côte, ce qui m’obligeait à tourner la tête pour observer son profil, ses mains, et surtout son sourire.
Lui aussi me regardait avec une gourmandise à peine retenue, et je m’aperçus que jamais mon mari ne m’avait désirée ainsi. Il est vrai que l’amour entre mon bibliothécaire d’époux et moi n’avait rien de charnel ni de spontané, il s’agissait plutôt d’estime et de complicité entre deux êtres qui partagent une même passion pour la lecture, qui sont heureux de se prêter mutuellement leurs bouquins, pour ensuite échanger des impressions sur les personnages ou sur l’auteur. Par honnêteté, je dois ajouter que je ne m’en étais jamais plainte, au contraire. Mon mari et moi partagions une relation équilibrée, très rassurante. N’empêche que j’étais en train de flamboyer face à cet inconnu, à qui j’avais envie de poser une multitude de questions indiscrètes.
Dérangée par la serveuse du salon de thé, je choisis un peu au hasard une coupe de glace au caramel et aux marrons glacés. J’ignore ce qu’il prit, car je ne regardais que lui.
Il m’expliqua qu’il était ingénieur chimiste et qu’il travaillait sur les plates formes pétrolières, il y restait deux mois d’affilée, puis venait se détendre à Paris durant quinze jours. Aussitôt, je lui demandai si ces horaires de travail particuliers ne nuisaient pas trop à sa vie familiale, et je fus heureuse de l’entendre me répondre que, Dieu merci, il était resté célibataire. C’était pour connaître sa situation, que j’avais posé ma question. Il dut s’en douter, d’ailleurs, car ses approches se firent aussitôt plus directes. Et dès que j’eus fini ma glace, aussi délicieuse qu’interminable, il me décrivit son appartement parisien, une folie qu’il s’était offerte sur la colline de Chaillot, avec vue sur presque tout Paris.
Prête à tout pour prolonger la conversation, j’oubliai ma timidité naturelle et je lui dis que j’aimerais beaucoup voir la Tour Eiffel, du haut de sa terrasse.
Une demi-heure plus tard, j’étais chez lui. Sans comprendre ce qui m’arrivait. Mais sans rien regretter non plus. Pourtant, avant même que j’aie pu aller admirer la Tour Eiffel, il m’embrassa avec une avidité que je ne connaissais pas encore, et que pourtant je partageais déjà.
Je savais qu’il allait me conduire vers sa chambre, je sentais que nous n’attendions tous deux que ce moment, mais il eut l’honnêteté de me faire asseoir sur l’un des fauteuils de son salon, le temps de m’avouer :
-Tout à l’heure, je vous ai menti. Je ne suis pas l’auteur de « Moissons et Vendanges ». En fait, je ne l’ai même pas lu, et le résumé que j’en ai fait ne correspond sûrement pas au véritable contenu du roman. Si j’ai prétendu être l’auteur d’un des livres que vous aviez achetés, c’est juste parce que j’étais attiré par vous, par votre démarche d’intellectuelle un peu bohème, qui prend le temps de regarder les vieux livres. J’ai senti que je devais vous surprendre, pour vous donner envie de m’écouter et de me suivre… Mais maintenant que nous nous connaissons, je tiens à redevenir sincère avec vous.
Je l’ai remercié par un sourire. Et à mon tour, je lui ai avoué que je n’avais pas été dupe un instant de son mensonge. Puisque c’est moi qui ai écrit « Moissons et Vendanges », durant l’été de mes vingt-cinq ans.
Il a encaissé la nouvelle avec élégance, en me demandant sur un ton faussement détaché :
-Rachetez-vous fréquemment vos propres livres chez les bouquinistes ?
En quelques mots, je lui ai expliqué que fréquemment, des amis ou des collègues de travail, surpris d’apprendre que j’avais publié des romans, me demandaient de leur en prêter un. Certains d’entre eux ne me le rendaient pas, d’autres me disaient vouloir l’acheter, bref j’étais toujours en manque de mes propres livres. Comme la plupart des auteurs, j’imagine. Aussi les rachetais-je quand j’en trouvais un exemplaire bon marché.
-Je n’ai pas eu de chance, soupira-t-il, avec un sourire qui démentait ses paroles.
Il était visiblement ravi, et un peu flatté que, sans le croire, je l’ai suivi jusque chez lui. Puisque mon attirance était démasquée, je me suis rapprochée de lui, et c’est moi qui ai recommencé à l’embrasser. Il m’a entraînée dans sa chambre, sans que je pense à protester, moi qui pourtant n’avais jamais trompé mon mari et qui croyais que la passion était juste une belle invention des écrivains romantiques. J’ai découvert ce jour-là un désir et une complicité aussi intenses que les amours décrites par Gérard de Nerval ou Alfred de Musset.
En fin d’après-midi, Philippe m’a dit qu’il restait à Paris une semaine, et il a voulu savoir quand nous nous reverrions. Je lui ai promis de revenir le lendemain.
Nous nous sommes retrouvés chaque jour, jusqu’à son départ. Mes horaires de professeur me laissaient du temps libre, que mon mari ne pouvait contrôler puisqu’il était retenu par ses fonctions de bibliothécaire. Cette semaine-là, les copies à corriger de mes élèves se sont accumulés sur mon bureau, tout comme le linge à repasser dans sa corbeille, et les livres à lire sous ma table de chevet. Je m’en moquais un peu, je pensais seulement que Philippe partirait en mer du Nord dès le dimanche suivant, que je resterais deux mois sans le voir et que je devais me repaître de lui.
La veille de son départ, il m’a confié qu’il était tombé amoureux de moi dès qu’il m’avait vue :
-Comme tous les hommes qui ne lisent guère, je suis fasciné par les livres et ceux qui les aiment. Rien qu’à voir ta manière de les manipuler, j’ai senti que tu étais une littéraire, et j’ai eu envie de t’aimer.
Il ajouta qu’il s’était promis depuis longtemps d’écrire un roman, un jour. Ce qui le décourageait, c’était le trop grand nombre de bouquins publiés, et retirés de la vente sans avoir eu de lecteurs.
-Mais maintenant, je me sens prêt à le réaliser, mon chef d’œuvre. Ce ne sera pas un manuscrit qu’on envoie à un éditeur et avec lequel on essaie de capter des lecteurs anonymes. Non ce sera un exemplaire unique, rédigé à la main, pour toi seule.
Avant même de découvrir son style, j’étais fière de ce qu’il allait écrire pour moi, ou plutôt pour nous deux. Le dimanche, j’ai trouvé un prétexte pour dire à mon mari que je devais accompagner une collègue à l’aéroport. Là-bas, j’ai embrassé Philippe, sans pleurer. Puisque je savais que nous nous retrouverions.
Et en effet, il est revenu deux mois plus tard. Aussi beau, aussi passionné. Irrésistible.
Pour lui, j’ai appris à réorganiser mon emploi du temps, je travaillais de façon fébrile durant ses absences, afin de me montrer disponible dès qu’il rentrait à Paris. Seul, mon fils a remarqué le changement de mes habitudes. Mon mari, lui, continuait à me raconter ses lectures. Je le trouvais ennuyeux, ce qui était injuste puisque j’avais vécu comme lui jusqu’à ce que je rencontre Philippe.
Au fil des mois, les fin d’après-midis ne nous suffirent plus. Je me mis alors à mentir à mon mari, je m’inventais des remplacements de collègues malades, je prétendais faire du soutien scolaire. Je négligeais toute vraisemblance, tant j’avais besoin de regarder Philippe vivre, avant de le sentir contre moi. S’il m’avait demandé de venir m’installer avec lui, j’aurais infligé un divorce à mon mari, sans aucun remords. Mais Philippe était de ces hommes libres qui ne se lient jamais à une femme, même quand ils l’aiment.
Nous étions amants depuis trois ans lorsqu’il me dit qu’il devait partir effectuer des analyses dans le Golfe persique. Je dus insister pour qu’il m’avoue combien de temps durerait son absence. Cinq mois.
Pour la première fois, je pleurai devant lui, je ne pouvais retenir mes sanglots, au risque de lui paraître laide et étouffante. Cinq mois sans lui, c’était trop. C’était presque aussi douloureux qu’une rupture.
Il me consola de son mieux, mais sans me proposer de le suivre. Il me promit juste une surprise pour la veille de son départ. Ce qui ne me rassura pas, je déteste les surprises, et surtout je l’aimais trop pour n’être pas déçue par un cadeau, quel qu’il soit, je ne désirais que sa présence.
Le dernier soir, je mentis de nouveau à mon mari pour rester avec Philippe le plus tard possible. Vers minuit, il me tendit avec un sourire mystérieux « sa surprise » : c’était un énorme cahier, de plus de quatre cents pages reliées. Il m’avoua que c’était là le livre qu’il avait toujours rêvé d’écrire. Une histoire d’amour idéale, une de celles qui résistent à tout, à la morale des hommes, et même au temps. Philippe pensait à ce roman depuis son adolescence, mais c’est en me rencontrant qu’il avait ressenti avec davantage de force la nécessité de se mettre à l’ouvrage.
-Puisque, avec toi, je venais de trouver la lectrice idéale, celle qui saurait inspirer le roman, et lire entre les lignes les allusions à notre histoire. En plus, nos semaines de séparation me laissaient du temps pour écrire, en pensant à nous. Mais…
Il me fit signe de parcourir le cahier qu’il m’avait confié. Je l’entrouvris délicatement, submergée d’émotion par avance à la perspective de retrouver notre amour tel qu’il l’avait vécu.
Le livre était blanc. Philippe n’avait rien écrit, sinon les mots « Chapitre I » sur la première page.
-Eh oui, avoua-t-il, pour atténuer ma déception. J’avais les meilleures intentions du monde, mais j’ai passé des soirées entières à mordiller mon stylo ou à inscrire sur du papier brouillon des phrases que je raturais tout de suite après. J’ai fini par me rendre à l’évidence. Je ne serai jamais un écrivain.
Pour la première fois, lui que j’avais toujours connu sûr de lui, lui dont j’admirais les gestes élégants et précis, le corps robuste et athlétique, voici qu’il était en train de perdre son aisance à se chercher des excuses pour n’avoir pas triomphé d’un défi qu’il s’était fixé.
Alors, pour qu’il retrouve le sourire et le prestige que j’aimais, je suis venue à son secours, je lui ai expliqué qu’aucun écrivain ne peut restituer avec de simples mots usagés, la force d’un amour véritable, d’un amour pétri de la chaleur de deux corps. J’ai ajouté que notre passion était sans doute plus forte que les autres, ce qui avait rendu encore plus difficile la mission qu’il s’était assignée. Et pour le lui prouver, je lui ai juré que dans aucun roman, pas même dans ceux de mes écrivains préférés, je n’avais lu un amour tel que le nôtre.
J’étais sincère.
Il l’a compris, et ainsi rassuré, il m’a rappelé qu’il était temps d’aller rejoindre mon mari. Il m’a juré que nous nous reverrions cinq mois plus tard.
Je l’ai embrassé. C’est seulement dans la voiture que je me suis demandé pourquoi il m’avait donné son cahier, pourquoi il ne l’avait pas emporté avec lui, pour essayer une fois encore de réussir son pari, durant ces cinq mois d’éloignement.
Aujourd’hui, je me pose toujours la question.
Avec d’autant plus d’intensité, que je n’ai jamais revu Philippe. Il a péri dans une explosion de la plate-forme pétrolière où il travaillait, le 25 Novembre 1991. Loin de moi.
Et ce soir-là, je n’ai même pas ressenti sa mort. J’ai appris l’accident par les journaux, le lendemain. Comme tout le monde.
Après des mois de désespoir, j’ai compris qu’il me restait à réaliser l’œuvre de Philippe, rédiger le livre qu’il rêvait d’écrire pour nous. J’y ai consacré trois années. Ensuite, j’ai envoyé le manuscrit à plusieurs éditeurs. Deux d’entre eux l’ont refusé très vite, peut-être sans l’avoir lu, mais un autre s’est déclaré prêt à le publier. A l’automne suivant, j’obtenais un premier succès de librairie avec ce roman que mon mari a longtemps pris pour une œuvre d’imagination. Il n’a commencé à manifester des doutes, que le jour où l’on m’a remis un célèbre prix littéraire.
Ce soir-là, face à l’enthousiasme communicatif de tous mes amis réunis pour la circonstance, et sous le sourire faussement désintéressé de mon éditeur, moi j’étais bien la seule à ne pas parvenir à retenir mes larmes…
Ajouter un commentaire